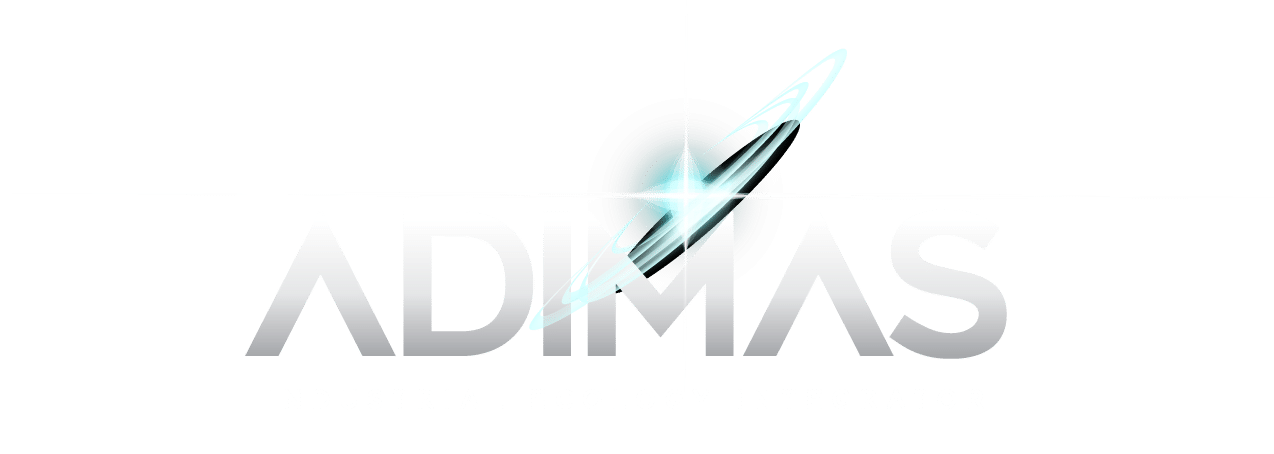La mission de GIEC peut-elle être considérée terminée ?
Depuis sa création, le GIEC continue de se répéter, donnant à chaque édition l’assurance de plus de certitude sur ses conclusions, qui restent de la même nature : les émissions de CO2 causent un changement climatique, dont les effets sont néfastes et qui se poursuivra tant que l’humanité émettra des gaz à effet de serre.
On peut se poser la question suivante : Le GIEC a-t-il encore une raison d’exister ? Cette question est soulevée par le journaliste environnemental Stéphane Foucart, dans un article dans Le Monde : « A quoi sert encore le GIEC ? ».

Stéphane Foucart écrit pour Le Monde depuis plus de 15 ans. Il couvre en particulier les sciences environnementales. Il est auteur entre autres de Le populisme climatique : Claude Allègre et Cie, enquête sur les ennemis de la science, 2010 et coauteur de Les Gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique, 2020.
En effet, la VIème édition du GIEC ne dévie pas de la ligne qu’il trace depuis sa création en 1988. Le rôle du GIEC est d’informer les autorités sur le consensus des sciences climatiques, pour aboutir à des actions politiques adaptées. Or le même type d’action est recommandé à chaque fois : réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre.
On peut regarder à quel point l’Accord de Paris est peu respecté, pour se convaincre que les recommandations ne se convertissent pas assez en actes. Si le GIEC n’a pas mené à une réaction suffisante en six rapports, c’est peut-être que la perspective d’une prochaine édition repoussera toujours la prise de décision. Si un rapport définitif était posé, est-ce que les décideurs sortiraient de la procrastination ?
Le GIEC rassemble les connaissances en sciences climatiques pour les transmettre aux non-scientifiques. Mais il ne suffit pas de savoir que l’on va droit dans le mur, le plus important est de s’arrêter avant.
D’autres personnes remettent en question la légitimité du GIEC, certains remettent même en question sa crédibilité, comme les membres de l’Association des climato-réalistes, présidée par le mathématicien Benoît Rittaud. Ce dernier a écrit une tribune intitulée « Sixième rapport du GIEC : et si on passait enfin à autre chose ? ».

Auteur du livre « Le Mythe climatique », Benoit Rittaud ne remet pas en cause l’existence du changement climatique mais le fait qu’il soit causé par le carbone atmosphérique.
Il critique les modèles climatiques du GIEC, qu’il accuse d’être une organisation bureaucratique répandant l’alarmisme climatique, en présentant des possibilités extrêmes, sur lesquelles la presse se concentre.Photo : climato-realistes.fr
Ces deux hommes ont des positions très différentes sur le climat.
Ils se rejoignent pourtant sur le fait que le GIEC se répète, de rapport en rapport.
Leurs raisons de le faire sont différentes puisque Benoît Rittaud critique le contenu du rapport, ce qui n’est pas le cas de Stéphane Foucart. Ce dernier semble juste de se questionner sur la tendance des États à reconnaître le travail du GIEC et signer l’Accord de Paris, quand ils ne parviennent pas à faire suivre ses objectifs pourtant engagés.
Si l’on connait la cause du changement climatique, alors il faut trouver et appliquer le meilleur moyen de l’atténuer et de se protéger de ses conséquences néfastes.
Les voix critiques face aux rapports de GIEC
Les règles des débats scientifiques ne sont pas les mêmes que celles des débats politiques. Le GIEC compile la littérature scientifique pour présenter la situation climatique au monde. En mars 2022, on devrait connaitre les prochains conseils du GIEC sur les actions à prendre face aux conséquences du changement climatique.
Le GIEC est aujourd’hui l’organe qui est sensé guider les politiques environnementales mondiales. Il reçoit tout de même des critiques portées par plusieurs voix, à différents degrés d’opposition et de climato-scepticisme.
Nous avons choisi de présenter deux personnages aux parcours bien différents : Michael Shellenberger et Christian Gerondeau.
M. Shellenberger est un militant politique et humanitaire américain, activiste environnemental et social.
C. Gerondeau est un essayiste et haut fonctionnaire français.
Tous deux sont des auteurs qui ont récemment fait parler d’eux par leurs positions critiques de l’environnementalisme actuel. Ils se rapprochent sur leur relativisme quant à l’urgence climatique : selon eux, le changement climatique ne menace pas le futur de la civilisation moderne.
Cela dit leurs similitudes s’arrêtent là.
Si Michael Shellenberger a critiqué les stratégies d’environnementalistes dans la lignée de Greta Thunberg, il ne doute pas des conclusions du GIEC comme Christian Gerondeau peut le faire.

Michael Shellenberger – Fondateur et président de l’association Environmental Progress, qui œuvre en faveur de thématiques environnementales, comme la protection d’espèces menacées. Il se définit comme un écologiste pragmatique. Il est notamment connu pour ses prises de position en faveur du nucléaire et d’un mouvement « écomoderniste », qui prône les développements technologique et économique comme atouts face aux menaces environnementales.
Shellenberger est un activiste environnemental et social depuis plus de 30 ans.
Il commence l’activisme en 1987, à 16 ans, avec une collecte de fond pour l’association Rainforest Action Network.
Shellenberger est diplomé en 1993 du programme « Peace and Global Studies » de l’Earlham College, Indiana.
Il co-écrit avec Ted Nordhaus Break Through: From the Death of Environmentalism to the Politics of Possibility, publié en 2007.
Pour ce livre ils seront nommés « Héros de l’environnement » par le Time Magazine.
Il fonde les associations The Breakthrough Institute, avec Ted Norhaus en 2003, et Environmental Progress en 2016, qu’il préside en déclarant deux objectifs :
« Nature and prosperity for all »
- Sortir tous les humains de la pauvreté
- Sauver l’environnement naturel.
Ces deux associations sont associées à l’écomodernisme.
En 2018, il est un des candidats démocrates au poste de gouverneur de Californie. En 2020, il écrit pour Forbes : On Behalf Of Environmentalists, I Apologize For The Climate Scare, édito dans lequel il dénonce les abus des environnementalistes et fait la promotion de son livre nouvellement publié : Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All.
Il y dénonce la « Climate Scare », c’est-à-dire la création par les médias et certains environnementalistes d’un sentiment de peur et d’urgence face au changement climatique. Selon lui cette communication est disproportionnée et empêche la prise de décisions rationnelles.
Voici quelques extraits de l’édito :
« Climate change is happening. It’s just not the end of the world. It’s not even our most serious environmental problem. »
Traduction :
Le changement climatique est en cours. Ça n’est juste pas la fin du monde. Ça n’est même pas noter problème environnemental le plus sérieux.
Shellenberger avance que le changement climatique ferra peu de victimes, surtout si de bonnes mesures sont prises pour protéger les populations.
« Climate change is not making natural disasters worse »
Traduction :
Le changement climatique ne fait pas empirer pas les catastrophes naturelles.
Pour faire cette affirmation, Shellenberger se base sur le nombre de victimes et la quantité de dégâts (calculés en impact économiques) occasionnés par les catastrophes naturelles. Il ne commente pas l’évolution des catastrophes naturelles en elle-même. Ses critères pour juger l’importance des catastrophes naturelles sont leurs impacts sur les vies et infrastructures humaines.
Cela dit, on ne peut pas déterminer avec certitude la différence en nombre de victimes attribuables au changement climatique.
« Habitat loss and the direct killing of wild animals are bigger threats to species than climate change »
Traduction :
Les pertes d’habitat et la mise à mort directe des animaux sauvages est une plus grande menace envers les espèces que le changement climatique.
Le problème de la perte d’habitat est lié à celui du changement climatique. S’il n’en est pas la seule cause, la perte d’habitat est favorisée par les modifications du climat. Dans la majorité des cas, un phénomène à de multiples causes.
« The build-up of wood fuel and more houses near forests, not climate change, explain why there are more, and more dangerous, fires in Australia and California »
Traduction :
L’accumulation de bois sec et d’habitations à proximité des forêts, pas le changement climatique, expliquent pourquoi les feux de forêt sont plus nombreux et dangereux, en Australie et Californie.
Shellenberger s’est exprimé contre certains dirigeants californiens, qui donnent le changement climatique comme cause des feux de forêts, alors qu’ils baisseraient le budget dédié à la gestion de ces dernières.
Il met en avant la stratégie des feux contrôlés comme moyen de lutte efficace contre les incendies massifs.
Mais, il n’y a pas une cause unique aux problèmes environnementaux. Le changement climatique et une mauvaise gestion des forêts peuvent être des causes conjuguées de ces incendies.
« The most important thing for reducing air pollution and carbon emissions is moving from wood to coal to petroleum to natural gas to uranium »
Traduction :
Le plus important pour réduire la pollution de l’air et les émissions de carbone est de passer du bois au charbon, puis au pétrole, puis au gaz naturel, puis à l’uranium.
Shellenberger met en avant l’importance pour les pays défavorisés d’augmenter leur production d’énergie, et d’en changer progressivement de source. Il décrit un enchainement de sources d’énergie de moins en moins polluantes et de plus en plus efficaces, le nucléaire étant la source qu’il préconise car décarbonnée et pouvant répondre aux demandes modernes.
Les pays développés ont pu élever leur niveau en commençant par utiliser les sources d’énergie les plus faciles d’accès.
Pour lui, Il faut donc permettre aux autres nations d’en faire autant, afin qu’ils atteignent plus vite un haut niveau de développement. Les prises de position de Michael Shellenberger ne s’arrêtent pas à ses critiques de l’environnementalisme. Il est en faveur du rassemblement des populations dans les villes, afin de laisser plus d’espace à la nature. Il est notamment en faveur du nucléaire, et se concerne aussi de sujets sociaux comme l’addiction.
Il a plusieurs fois été invité à participer à des conférences TEDx, pour y présenter ses convictions.

Christian Gerondeau – Ancien polytechnicien diplômé de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, Christian Gerondeau est un ingénieur et haut fonctionnaire français.
Il est tout d’abord connu pour avoir été Délégué interministériel à la sécurité routière dans les années 70. A ce poste c’est lui qui instaure les limitations de vitesses et le port obligatoire du casque de moto et de la ceinture de sécurité. Ces mesures contribuent largement à réduire le nombre de morts sur la route (18 034 en 1972 contre 3 244 en 2019), bien qu’elles aient rencontré de nombreux réfractaires à l’époque, notamment dans l’industrie automobile.
Christian Gerondeau publie plusieurs ouvrages, surtout au sujet des transports en France, avant de se pencher sur l’écologie et le climat, en 2007 (L’écologie et les imposteurs et Écologie, la grande arnaque), qui deviendront ses sujets de prédilection.
En effet, il est membre de l’Association des climato-réalistes. S’il ne nie pas le changement climatique, il avance que l’humanité n’aurait pas d’impact sur les variations du climat et que ces dernières seraient de toute façon négligeables. Il accuse le GIEC et les écologistes de ne pas respecter une démarche scientifique, mais d’entretenir un catastrophisme et un dogme religieux (La religion écologiste, 2021).
Il critique l’environnementalisme sur plusieurs points, dont voici quelques exemples :
1. Le réchauffement global observé, par rapports aux scenarios du GIEC
Le 4 juillet 2021, Christian Gerondeau est invité sur la chaine C News, en tant qu’essayiste, pour présenter ses idées sur le réchauffement climatique.
Entre autres, il y présente un graphe, publié dans le troisième rapport du GIEC (2001), montrant plusieurs scénarios d’évolutions de la température mondiale. Il affirme que la réalité en 2020 correspond aux scénarios les moins chauds présentés dans le rapport.

Extrait du troisième rapport du GIEC : AR3
Scénarios d’évolution de la température moyenne globale, par rapport à 1990
Point rouge placé par C.Gerondeau
Note : Ce graphique prend en référence la température globale moyenne de 1990.
Les valeurs de réchauffement discutée dans l’Accord de Paris et le sixième rapport du GIEC se réfèrent à la moyenne de 1850 à 1900 (niveau préindustriel). Sous cette référence le réchauffement en 1990 était de 0,5°C.
Le docteur Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe 1 du GIEC, a réagi à cette intervention sur twitter et a signalé l’émission au CSA. Elle juxtapose le graphe en question avec les données de températures actuelles, pour montrer que Christian Gerondeau sous-estime le réchauffement d’environ 0,2°C.

Superposition graphique
des scénarios publiés par le GIEC dans son troisième rapport
avec les données de températures de l’Hadley Centre
On peut donc voir qu’il y a un décalage entre le point rouge posé par Christian Gerondeau et la température en 2020 selon les données de l’Hadley Centre, employées par Valérie Masson-Delmotte (ici représentées par un point vert).

Extrait du troisième rapport du GIEC : AR3
Scénarios d’évolution de la température moyenne globale, par rapport à 1990
Point rouge placé par C.Gerondeau
Point vert placé pour correspondre aux données de l’Hadley Centre;
Pour rappel le réchauffement global en 2021 est de 1,1°C.
Un décalage de 0,2°C peut sembler minime. Il s’agit tout de même d’une erreur de 18%. On peut observer sur le graphe qu’un parcours différent est suggéré.
Dans son sixième rapport le GIEC mentionne que la limite de 1,5°C de réchauffement (fixée par l’Accord de Paris) à une forte probabilité d’être dépassée avant la fin du siècle.
2. La montée des eaux
Gerondeau met en évidence la montée du niveau de la mer, qui est d’environ 2mm par an en moyenne, depuis 1901.
Cela conduirait à une montée des eaux de 20cm en un siècle. Ce n’est pas selon lui une menace importante pour les littoraux et les populations qui vivent proche du niveau de la mer.
D’après le GIEC la montée des eaux varie dans le temps. Elle était de 1,3mm entre 1901 et 1971, tandis qu’entre 2006 et 2018 elle était de 3,7mm.
Cette accélération de la montée des eaux pourrait se poursuivre avec l’évolution du changement climatique, la montée des eaux serait alors plus importante.
La montée des eaux n’atteint pas tous les littoraux de la même façon.
Dans certains endroits, les mouvements des plaques tectoniques poussent les terres à s’élever d’avantage que la mer.
3. La futilité de la lutte contre les énergies fossiles
Pour Christian Gérondeau, l’humanité n’est pas responsable du changement climatique, simplement car le CO2 ne génère pas de réchauffement. Il considère donc les mesures prises contre les énergies fossiles comme inutiles, et même mauvaises pour l’économie.
Plus encore, les besoins énergétiques grandissant des pays en développement seraient la garantie que la totalité des ressources fossiles seraient un jour consommées, car elles sont la source d’énergie la plus accessible.
La part grandissante de ces pays dans les émissions mondiales rendraient alors futiles tous les efforts faits par les pays développés.
Selon Gerondeau, les émissions de CO2 par l’humanité sont insignifiantes par rapport à la masse de CO2 déjà présente dans l’atmosphère.
La fraction de CO2 dans l’atmosphère est aujourd’hui de 412 ppm.
Avant l’industrialisation cette valeur était de 280ppm.
(412 molécules de CO2 sur un million de molécules dans l’air)
Cela correspond à une masse de plus de 3200 Gigatonnes de CO2 dans l’atmosphère.
Chaque année, l’humanité émet plus de 30 Gigatonnes de CO2.
Cela correspond à environ 1% du stock dans l’atmosphère, mais cela ne rend pas ces émissions insignifiantes pour autant.
D’après le GIEC, il faut environ 100 Gigatonnes de CO2 pour réchauffer l’atmosphère de 0,1°C. Or chaque dixième de degré suffit à impacter les conditions climatiques mondiales.
Les arguments de Gerondeau sont assez courants chez les opposants de l’environnementalisme et du GIEC à une différence pret : Gerondeau met aussi en question les motivations politiques de cette organisation.
Conclusion
Pour finir, Shellenberger et Gerondeau reçoivent eux aussi des critiques intéressantes pour leurs prises de position, ou les arguments qu’ils utilisent.
Le changement climatique est aujourd’hui largement admis, et les gouvernements sont peu divisés pour accepter son origine anthropologique.
Les désaccords dans le débat public sont néanmoins nombreux et concernent avant tout les moyens à mettre en œuvre afin d’y faire face, au niveau mondial.
Les émissions de carbone émises localement ont des répercussions au niveau mondial. Toutes les régions du monde ne sont pas à égalité devant les conséquences du changement climatique, ce qui malheureusement participe à différencier le niveau d’engagements de différents pays et ralentie les résultats des efforts accomplis.